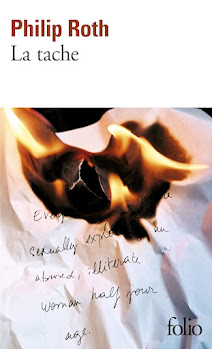The Truth about women est une œuvre s'inscrivant pleinement dans la démarche féministe d'une grande part de la filmographie de Muriel Box. Elle fut une des rares réalisatrices du cinéma britannique durant les années 50/60, s'imposant à force de volonté dans ce milieu masculin et condescendant à son égard. Elle a derrière elle une longue carrière de scénariste, contribuant à quelques belles réussites où elle met déjà en lumière de beaux personnages féminin comme The Brothers de David MacDonald (1947) et surtout Le Septième voile de Compton Bennett (1945), un des grands succès populaires du cinéma britannique de l'époque (et Oscar du meilleur scénario), produit au sein du studio Gainsborough. Elle épouse Sydney Box en 1935 et l'ascension de ce dernier dans les hautes sphères du cinéma britannique (il deviendra le président du studio Gainsborough à la fin des années 40 puis fondera sa compagnie London Independent Producers) va contribuer à assouvir ses ambitions de réalisatrice. Il dirigera 13 films entre 1949 et 1964, sans forcément rencontrer de véritable reconnaissance critique ou même de bénéficier de solidarité féminine puisque Jean Simmons la fera remplacer sur le tournage de Si Paris l'avait su (1950) et Kay Kendall tentera sans succès de faire de même pour Simon and Laura (1955). Après des premiers films adaptés de pièces de théâtre, elle oriente plus spécifiquement sa filmographie sur des thèmes féministes comme The Passionate Stranger (1957), Rattle of a Simple Man (1964) et donc The Truth about women.Le film s'ouvre sur le courroux d'un mari venu chercher son épouse réfugiée chez ses beaux-parents après une querelle. Le tempérament trop indépendant de sa femme lui semble impossible à gérer, et il va falloir une leçon de vie de son beau-père, Humphrey Tavistock (Laurence Harvey), pour s'apaiser et faire évoluer sa vision du monde. Le film devient ainsi une sorte de récit à sketches où Tavistock va narrer ses amours malheureuses passées, chaque histoire constituant une fable et situation différente sur les entraves imposées aux femmes. Comme tout film à sketch, c'est très inégal et d'autant plus ici que les histoires les plus longues sont largement les moins intéressantes. Parmi les ratages manifeste on peut signaler la seconde histoire où, nommé diplomate en Turquie, Tavistock tombe amoureux d'une jeune femme vendue en esclave à un sultant pour son harem.Les clichés racistes et les dialogues désobligeants sont légion dans une Turquie arriérée dont l'esthétique fleure bon le conte des Mille et Une Nuits. Muté à Paris après cette mésaventure, Tavistock plonge cette fois dans les pires poncifs du vaudeville avec amant caché sur le balcon, mari jaloux adepte du duel et femmes vénales (symbolisée par Eva Gabor) se mariant pour l'argent et entretenant ensuite la bagatelle avec leurs amants. Une belle image de la France et un drôle de film féministe, se dit-on à ce stade - un autre plus court segment tout aussi lourd mettra en boite les Américaines.En revanche dès que l'on s'éloigne de cet "exotisme" rebattu, le film trouve sa voie. Le sketch d'ouverture montre le long chemin à parcourir pour Tavistock lorsqu'il tombera amoureux d'Ambrosine (Diane Cilento), jeune femme moderne vivant seule, adepte de la conduite en voiture effrénée et suffragette. Tavistock sous le charme ne peut cependant franchir le pas de ce qu'attends de lui Ambroisine suite à sa demande en mariage : vivre en union libre un an avant de franchir le pas. Notre héros n'a que des arguments sociaux et machiste à opposer à cette demande, refusant d'être entretenu par sa compagne et craignant le regard des autres quand il devra présenter celle qui vit avec lui sans être encore son épouse légitime. Ces œillères et des circonstances malheureuses vont donc les séparer. Plus tard Muriel Box orchestre un délicieux moment romantique lorsque Humphrey va se trouver coincé dans un ascenseur avec Helen (Julie Harris) jeune femme peintre en route pour se marier. L'espace confiné devient un lieu de confidence, de rapprochement et de coup de foudre saisit avec délicatesse dont les deux étrangers ressortent amoureux et prêt à se marier. Havelstock ruiné découvre alors la dévotion faite femme avec une Helen lui offrant des instants de bonheur dans le plus grand dénuement matériel avant que le sort vienne de nouveau frapper.L'ultime sketch est aussi le plus ouvertement engagé, lorsque Humphrey en couple avec l'infirmière (Mai Zetterling) l'ayant soigné après-guerre voit le mari dont elle est séparée lui intenter un procès et lui réclamer une somme indécente pour réparation. Le récit est moderne est captivant, opposant une vision où la femme est un bien dont on se dispute la propriété et celle la laissant libre de ses choix de vie, le tout sous le regard inquisiteur du tribunal et de la société. Dès que Muriel Box traite son récit sous un angle intimiste, sociétal et plus spécifiquement anglais, c'est très original, touchant et réussi. Mais les quelques segments ratés tombent à l'inverse dans le cliché grossier et paradoxalement dans le machisme. Une qualité qui traverse cependant tout le film est le brio formel de Muriel Box. Le film est vraiment un régal pour les yeux, la direction artistique est somptueuse, notamment la partie française avec son esthétique Belle Epoque et ses superbes compositions de plan. La campagne anglaise dans la partie "Ambrosine" est là aussi magnifiquement capturée, le tout dans l'écrin chatoyant de la photo bariolée de Otto Heller. Très inégal donc mais pas inintéressant.
Sorti en bluray anglais chez StudioCanal et doté de sous-titres anglais